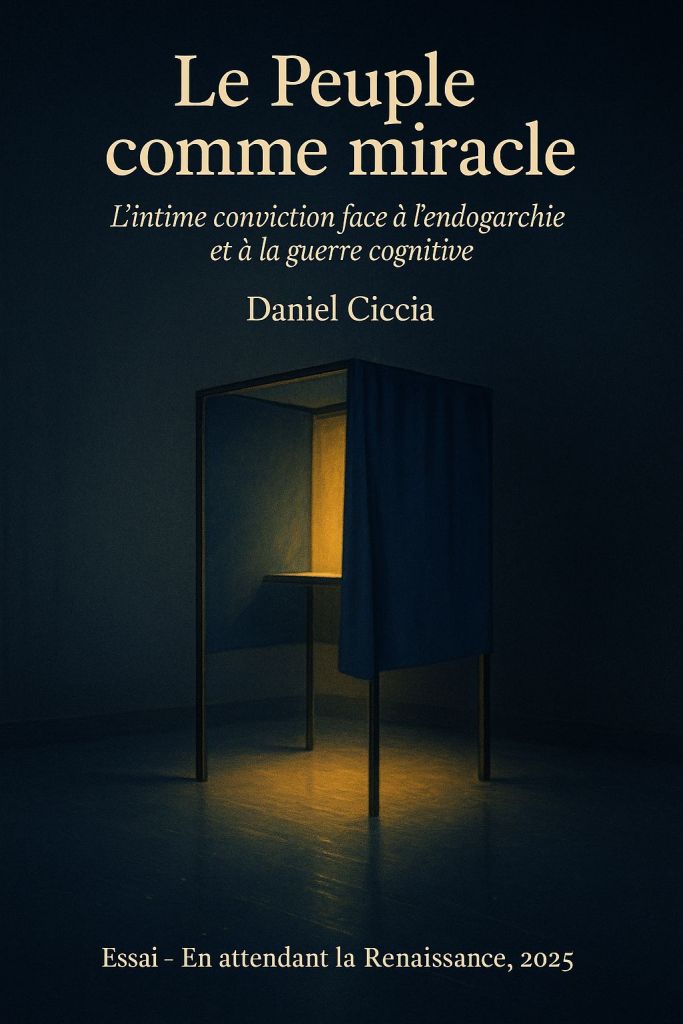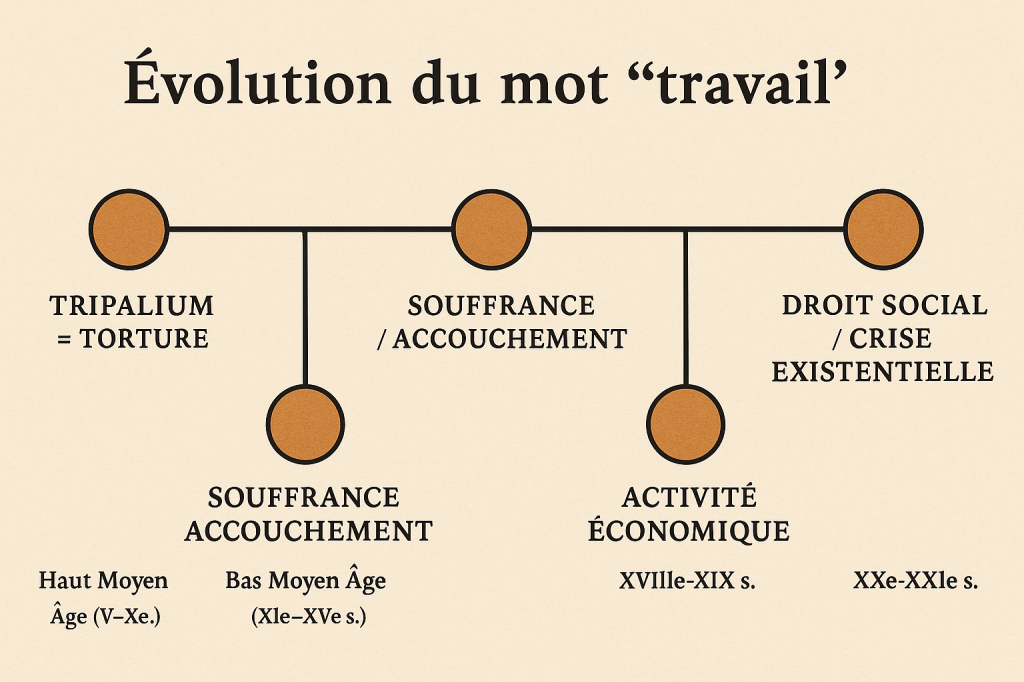L’idée d’un “choc des civilisations”, formulée par Samuel P. Huntington au tournant des années 1990-2000, n’a pas seulement proposé une lecture : elle a dressé le décor mental d’un monde en guerre cognitive. Au moment où la laïcité semblait pouvoir servir de fil d’Ariane pour les démocraties occidentales, Huntington a tracé une architecture cognitive selon laquelle l’identitaire, le religieux et le culturel remplaceraient l’idéologique et l’économique comme moteurs des conflits.
Même s’il se défendait d’incarner ou de promouvoir ce “clash”, il a offert, à partir de 1993, aux adversaires de l’ordre mondial – qu’ils soient idéologues, terroristes ou stratèges – le fond vert idéal pour insérer leurs agissements dans un décor idéal pour eux.
Ce chapitre s’ouvre donc sur un constat simple : nous avons tourné un quart de notre siècle sur ce drap vert idéologique, et désormais la scène s’éclaire — mais faut-il encore savoir ce que nous voyons. Et reprendre la copie.
Prologue – Le flash du siècle
Le 11 septembre 2001 fut plus qu’un attentat : ce fut un flash planétaire, un instant d’illumination violente où la prophétie de Huntington se projeta, d’un seul coup, dans toutes les consciences.
En quelques minutes, l’image de deux avions frappant les tours jumelles grava dans la rétine collective le scénario du “choc des civilisations”.
L’événement pulvérisa les distances : il abolit la médiation, fit exploser la temporalité politique et transforma la peur en expérience simultanée de l’humanité tout entière.
Ce jour-là, la planète découvrit qu’elle pouvait être unie… dans la sidération. La mondialisation de la confiance, avec ses organes de régulation basés sur le droit, cédait à la mondialisation de la peur.
Le “fond vert” imaginé par Huntington devint l’écran mental sur lequel chacun — gouvernant, idéologue, croyant ou simple spectateur — projetait son récit du monde.
La prophétie trouva son projecteur : la télévision.
Et son amplificateur : Internet.
En une journée, le langage de la fracture remplaça celui du dialogue.
Les nuances se dissocièrent, les appartenances se raidissent, les croyances se politisèrent.
Ce flash inouï fertilisa un terreau propice à la violence verbale, à l’anathème, à la radicalisation et au terrorisme.
Il inocula dans les sociétés modernes une peur transmissible : celle de l’autre.
Depuis ce jour, chaque crise majeure — terroriste, migratoire, identitaire — réactive, sous d’autres formes, ce choc initial.
Le XXIᵉ siècle tout entier se déroule dans la lumière brûlée du 11 septembre,
comme si le monde n’avait jamais quitté ce plan unique de feu et de poussière.

I. Le fond vert du monde
Il est des idées qui ne décrivent pas le monde : elles le fabriquent. En 1996, Samuel Huntington, professeur à Harvard, spécialiste des relations internationales et du développement politique, publie The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.
Ce texte, souvent cité mais rarement relu, est devenu l’un des plus puissants générateurs de mythes politiques du monde contemporain.
Car, même s’il s’est toujours défendu d’être le prophète d’un affrontement global, il en a dressé le décor — comme un réalisateur tendant un drap vert derrière des acteurs encore hésitants, sur lequel viendraient s’incruster, plus tard, les images de toutes les haines du XXIᵉ siècle.
Sur ce fond abstrait, chacun projeta son propre film :
- Alexander Dugin, théoricien d’un eurasianisme mystique, y inscrivit la guerre sacrée contre l’Occident matérialiste.
- Oussama Ben Laden y lut la validation d’un combat eschatologique entre islam pur et monde corrompu.
- Et l’Occident lui-même, croyant répondre à la menace, y trouva la justification d’une militarisation de la pensée et d’une économie de la peur.
Huntington, en voulant prévenir le choc, a fourni la matrice cognitive où il allait se produire.
Il a offert au monde post-soviétique un langage totalisant — celui de la fracture civilisatrice — et donné à la guerre sans nom des années 2000 un cadre conceptuel où s’enraciner.
Ce n’était pas un manifeste : c’était un fond vert.
Et sur ce fond, les puissances du ressentiment ont tourné leur film.
Puis, le 11 septembre 2001, le scénario prit vie.
Alors que la fumée montait de Manhattan, un acteur monta sur scène : Benjamin Netanyahou, déclarant :
“Now we know what is attacking us. You understand us now. We can bring you our experience and expertise.”
En une phrase, il fit ce que Huntington n’avait pas osé faire : désigner l’ennemi et assigner un camp.
L’Occident sidéré s’aligna sur la grille du choc ; le paradigme civilisationnel devenait opératoire.
Dès lors, chaque attentat, chaque crise, chaque guerre ne ferait que rejouer la même scène, sur le même décor.
La guerre hybride, avec sa perverse composante que représente, la guerre cognitive, pouvait, dès lors, commencer. A ce jeu, certains se sont révélés plus habile à maîtriser les dimensions tactiques et stratégiques de ce haut et insidieux de gré de conflictualisation.
II. Le piège de la prophétie : penser le monde avec les catégories de ses ennemis
Une prophétie ne devient dangereuse que lorsqu’elle s’accomplit dans l’esprit de ceux qui la redoutaient.
Le Choc des civilisations fut de cette nature : une métaphore devenue carte du monde.
L’Occident, en cherchant à nommer ce qui le menaçait, a fini par penser avec les catégories de la menace.
Il s’est enfermé dans la logique du “eux” et du “nous”, du “monde libre” contre “l’axe du mal”, du “raisonnable” contre le “fanatique”.
Ces mots, jadis outils d’analyse, sont devenus frontières mentales.
Le piège se referma comme une cage logique : le réel ne pouvait plus être vu que dans le langage du choc.
Et, à mesure que les bombes tombaient et que la peur se banalisait, la pensée occidentale s’est appauvrie, totalitarisée par son propre lexique.
Ainsi, ceux qui prétendaient combattre le fanatisme lui ont emprunté sa structure :
ils ont transformé le monde en un théâtre binaire,
où la nuance équivalait à la trahison et la complexité à la faiblesse.
Le 11 septembre ne fut pas seulement un attentat : ce fut la consécration d’une prophétie auto-réalisatrice.
En cherchant à conjurer la guerre des civilisations, l’Occident l’a pensée, dite, puis mise en scène.
Et tandis qu’il se croyait lucide, il devint figurant de sa propre tragédie et, saturé de foulards islamiques, d’Allah Akbar, de têtes de cochons devant les mosquées, de tags antisémites, de croix gammées sur les synagogues, d’église qui brûlent, et de profanations en série, de sa propre perte de souveraineté dans l’écriture de son propre récit, dans la maîtrise de l’essence qui fait son être.
III. La mondialisation du choc : comment l’Apocalypse est devenue un marché
Le Choc des civilisations a cessé d’être une théorie pour devenir un produit dérivé.
Une marque mondiale.
Une trame narrative universelle sur laquelle les pouvoirs, les médias et les entreprises ont appris à capitaliser.
La guerre du sens, d’abord idéologique, s’est industrialisée.
Elle alimente aujourd’hui un écosystème où la peur est cotée, la colère monétisée, et l’indignation convertie en parts d’audience.
Chaque crise, chaque attentat, chaque polémique devient matière première pour l’économie de l’attention.
L’Apocalypse est devenue un format.
Et plus l’humanité se fracture, plus le système prospère.
La haine, la désinformation, la suspicion ne sont plus des pathologies : elles sont des valeurs d’échange.
Là où l’on croyait voir le conflit des civilisations, on découvre désormais le commerce des narrations.
Le monde ne se divise plus entre Est et Ouest, ni entre foi et raison, mais entre ceux qui manipulent les récits et ceux qui les subissent.
IV. Le retour du sens : restaurer la souveraineté cognitive de l’Europe
Nous vivons aujourd’hui la phase terminale d’une métastase mentale.
Ses symptômes ne sont plus invisibles : ils se manifestent chaque jour dans la difficulté, même pour ceux dont c’est le rôle — journalistes, diplomates, chercheurs, gouvernants —, de penser le mal qui submerge tout sans se laisser happer par la logique qu’il impose.
Car le mal, désormais, ne se contente plus d’agir : il prescrit sa propre grille d’analyse,
et rares sont ceux qui échappent à son magnétisme tant il invite tous les protagonistes à le rejoindre, à l’alimenter, à un titre ou à un autre.
Du Soudan aux attentats sur le sol européen, du Crocus City Hall à Moscou à la crise migratoire que nul État ne parvient à maîtriser, le gagnant politique est presque toujours celui qui exploite le mieux la dialectique du choc : celui qui sait transformer la peur en légitimité, la souffrance en récit, et le chaos en outil de pouvoir.
Ce monde est devenu un livre qui s’écrit tout seul. Ses nouvelles pages s’ouvrent les unes après les autres sitôt qu’un sujet est consommé dans les précédentes.
Dans ce flot, les dissonances sont rares : la plupart des voix, qu’elles croient s’opposer ou s’affronter, finissent par se répondre à l’intérieur du même système narratif, celui du choc et de la peur, ce qui produit une auto-combustion inextinguible.
Ce sont précisément ces dissonances, ces éclats de pensée non synchronisés, qu’il faut désormais rechercher car elles permettent de tisser le réseau matriciel et ce sont elles, les dissonances, qui trahissent la nature des opérations qui téléguident la pensée publique dans ce corridor de la mort.
Sortir du piège, ce n’est donc pas nier le conflit, mais restaurer la hiérarchie du sens.
L’Europe, héritière des Lumières, ne vaincra pas par la force, mais par la lucidité.
Elle doit cesser d’être la caisse de résonance du chaos pour redevenir l’atelier du discernement.
Il faut apprendre à voir le fond vert, à reconnaître le décor truqué, à réapprendre la mise au point.
Car la liberté ne se mesure plus à la taille du territoire, mais à la clarté de l’esprit collectif.
Restaurer la souveraineté cognitive, c’est rendre au réel sa profondeur,
et au peuple sa conscience.
La souveraineté du XXIᵉ siècle ne se fera pas à partir des puissances exclusivement militaire ni monétaire : elle est et sera cognitive. Elle dépendra de la capacité des peuples à discerner ce qu’ils pensent de ce qu’on leur fait penser, ce qui constitue une hygiène élémentaire pour ne pas être que le punching-ball de poings tapant sur la matière grise.
Le champ de bataille est là. La dimension autoritaire de la Chine se développe, pour grande partie, dans ce contrôle plus légitime que jamais.
Les démocraties ont à établir le leur pour manifester que leur sort n’est pas scellé et encore moins désespéré. Qu’elles savent avancer dans le brouillard cognitif qui leur est imposé de l’extérieur pour n’illuminer que la voie ouverte à l’extrême-droite qui veut démanteler la puissance collective européenne, et enrayer sa dynamique.
Le moment que cela forme dans l’histoire rejoint ce qu’avait tenté de formuler André Malraux – propos apocryphe cependant conforme à toute sa pensée et à toute son œuvre – selon lequel « Le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas ».
C’était une manière de dire que ce siècle, aux potentiels si contradictoires, sortirait vainqueur par la puissance et l’acuité de l’Esprit.
C’est le combat de ce siècle. Le combat de ce siècle ce n’est pas la liberté d’expression.
Le libre-arbitre en est la clé.
Ce combat décisif qui déterminera – pour longtemps – le monde dans lequel grandira notre postérité, se mène et, surtout, se gagne – ou se perd – aujourd’hui ou dans les semaines qui viennent.
Je suis obligé de rendre hommage à André Malraux. Il fait partie des gens à avoir décelé – dans l’air du temps et ce qu’il recèle de mutations invisibles aux intelligences sensibles – ce qui nous est arrivé avant que le nuage sur forme et se transforme en ouragan dévastateur dans la psyché humaine. Il ne lui a suffit peut-être que la sensation de quelques ailes de papillons invisibles, un demi-siècle avant sa survenue – pour comprendre ce changement de climat et comment, dans un formule extraordinairement pénétrante et péremptoire, en conjurer les effets.
Je ne peux pas conclure ce chapitre V sans citer, aussi, Paul Valery. Il avait formé une partie du prologue à ma propre réflexion stratégique, que j’avais engagée en 2016 sous le titre « Vulnérabilité des Démocraties à l’âge de la Mondialisation ». Je l’avais rédigée, sans être allé au bout de la réflexion, qui est encore alimentée ici même, en réaction aux attentats du 13-Novembre-2015, dont nous allons bientôt commémorer les 10e anniversaire.
En 1936, quelques années avant le déclenchement de ce qui allait devenir la seconde guerre mondiale, dans son essai « Regards sur le monde actuel », le philosophe et poète sétois avait parfaitement situé le changement de matrice auquel il assistait.
« Mais sans doute des moyens un peu plus puissants, un peu plus subtils, permettront quelque jour d’agir à distance non plus seulement sur les sens des vivants, mais encore sur les éléments plus cachés de la personne psychique. Un inconnu, un opérateur éloigné, excitant les sources mêmes et les systèmes de vie mentale et affective, imposera aux esprits des illusions, des impulsions, des désirs, des égarements artificiels. »
Paul Valéry
Ces mots, écrits il y a près d’un siècle, sonnent aujourd’hui comme une prophétie accomplie.
L’homme moderne, connecté, surexposé, démultiplié, est devenu le médium de sa propre manipulation.
Les “égarements artificiels” dont parlait Valéry ne sont plus des fictions : ils sont devenus notre écosystème mental.
V. La bombe humaine : la guerre invisible de Vladimir Poutine
Vladimir Poutine exhibe son arsenal comme un prestidigitateur montre ses illusions : torpilles à tsunamis radioactifs levant des vagues de deux cents mètres, missiles à propulsion nucléaire capables de sillonner le ciel sur vingt mille kilomètres avant d’atteindre leur cible, promesses de supériorité hypersonique.
Il en est là : dans l’ostentation du spectaculaire.
Mais derrière ce théâtre de métal et de feu, il dissimule la véritable panoplie d’armes de destruction massive : les armes cognitives.
Ces armes ne détruisent pas les infrastructures ; elles fissurent les consciences.
Elles ne visent pas les villes ; elles infectent les représentations.
Elles ne pulvérisent pas la matière ; elles dévissent le réel.
Chacun, dans ce champ de bataille global, devient une grenade à fragmentation mentale, projetant autour de lui des éclats d’opinion, de peur, de certitude ou de haine.
Les frontières n’y existent plus : ni géographiques, ni politiques, ni morales.
La guerre n’est plus ce qui se livre “là-bas” ; elle s’invite dans la langue, dans les images, dans la mémoire, dans le rêve.
Pour en dire l’intuition poétique la plus juste, il faut revenir à Téléphone — ce groupe qui, au début des années 1980, pressentit la mutation à venir.
Dans La bombe humaine, Jean-Louis Aubert chantait :
Je veux vous parler de l’arme de demain,
Enfantée du monde, elle en sera la fin.
Je veux vous parler de moi, de vous.
Je vois à l’intérieur des images, des couleurs,
Qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur,
Sensations qui peuvent me rendre fou.
Nos sens sont nos fils, nous pauvres marionnettes,
Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes.
Ce texte, quarante ans avant l’avènement de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux, annonçait la bombe H de l’esprit — non pas “hydrogène”, mais humaine.
Une arme dont l’effet ne se mesure pas en mégatonnes, mais en degrés d’aliénation.
Pour la première fois dans l’histoire, l’homme a conçu des armes dont la cible principale n’est pas la matière vivante, mais la conscience vivante ;
des armes dont la puissance se constate non dans les ruines, mais dans le consentement de ceux qui croient encore penser librement.
Et, comme la bombe H, les armes cognitives ont cette particularité terrible qu’elles laissent debout les infrastructures, intactes les villes, apparemment paisibles les sociétés —
mais elles annihilent ce qui fait d’elles des civilisations.
VI. Le dernier refuge de l’esprit : comment résister sans devenir ce que l’on combat
Les civilisations ne meurent pas toutes de la même manière.
Certaines s’effondrent sous le poids des invasions ou des famines.
La nôtre, si elle devait s’éteindre, le ferait dans la lumière aveuglante de sa propre information.
Les armes cognitives ne détruisent pas les corps, elles dissolvent le sens.
Elles ne font pas couler le sang, mais le discernement.
Elles ne s’attaquent pas à la raison pour la nier, mais pour la saturer.
Le génie du chaos contemporain est d’avoir compris que la destruction n’a plus besoin de violence physique —
il suffit de remplir l’esprit jusqu’à ce qu’il se taise.
L’homme du XXIᵉ siècle ne craint plus la censure : il craint le vide laissé par l’abondance.
Il ne se révolte plus contre le mensonge : il s’y réfugie, pour ne plus penser seul.
Il ne combat plus l’ennemi : il cherche dans son propre camp un miroir rassurant de sa peur.
Ainsi se forment les masses liquides du monde postmoderne : mobiles, nerveuses, sans mémoire, prêtes à s’enflammer au contact du moindre signal.
Résister à cela ne consiste plus à dénoncer — le bruit du monde s’en charge déjà.
Résister, désormais, c’est rétablir la ligne claire :
celle qui distingue la pensée du réflexe, la foi du fanatisme, l’attention de la pulsion.
C’est redonner à la parole sa lenteur, à la raison sa gravité, à la vérité son coût.
Le dernier refuge de l’esprit, c’est la conscience.
Pas celle qui juge, mais celle qui veille.
Elle seule peut se soustraire à l’hypnose collective, refuser la contagion,
et faire de la lucidité une forme active de courage.
Les mots de Malraux résonnent alors comme un viatique pour ce siècle :
« Le XXIᵉ siècle sera spirituel ou ne sera pas. »
Il ne parlait pas de religion, mais de la reconquête de l’humain sur la technique, de la réappropriation du sens dans un monde saturé de signes.
C’est à cela que nous sommes rendus.
À l’heure où les bombes humaines se multiplient, où les intelligences artificielles prédisent nos désirs avant que nous les éprouvions, où la parole publique devient un champ de mines émotionnelles, il faut retrouver ce point fixe que ni la peur ni la propagande ne peuvent atteindre :
la présence lucide à soi-même.
Le dernier front de la guerre cognitive n’est pas militaire.
Il est intérieur.
Et c’est là que se jouera, silencieusement, le destin du monde.